Ce trouble, encore peu connu du grand public, peut entraîner une vraie souffrance psychologique, des comportements excessifs et parfois une spirale d’insatisfaction permanente, malgré les soins reçus. Il est essentiel de le comprendre pour mieux le détecter – chez soi, chez un proche – et pour pouvoir y répondre de la bonne manière.
Qu’est-ce que la dysmorphophobie ?
La dysmorphophobie, aussi appelée trouble dysmorphique corporel, est un trouble psychiatrique inscrit dans la catégorie des troubles obsessionnels compulsifs (TOC) dans lequel une personne est obsédée par un ou plusieurs aspects de son apparence qu’elle juge « anormaux », « laids », ou « déformés ».
Le plus souvent :
- Ce défaut est imaginaire, c’est-à-dire que personne d’autre ne le voit.
- Ou bien il est réel, mais perçu de manière exagérée par la personne elle-même.
Au final, l’image que la personne a d’elle-même ne correspond pas à la réalité. Elle souffre de cette différence, et pense souvent que changer son apparence est la seule solution pour aller mieux. Cette distorsion de la réalité affecte profondément la qualité de vie et peut interfèrer avec les relations sociales, professionnelles et affectives.
Un trouble fréquent… surtout chez les personnes qui consultent en esthétique
Dans la population générale, ce trouble toucherait environ 2 à 3 % des gens. Mais dans les cabinets de médecine ou de chirurgie esthétique, ce chiffre grimpe fortement : jusqu’à 1 patient sur 4 pourrait en être atteint.
Pourquoi ? Parce que ces patients sont naturellement attirés par les soins esthétiques, persuadés qu’une intervention suffira à « corriger » leur défaut et à les rendre plus heureux. Malheureusement, ce n’est jamais le cas : même après des soins réussis, la personne continue de se voir imparfaite, ou reporte son obsession sur une autre partie de son corps.
Comment reconnaître les signes ?
Il peut être difficile de faire la différence entre une envie légitime d’améliorer son apparence… et une obsession maladive. Voici quelques signaux d’alerte :
- Vous passez beaucoup de temps à vous examiner dans le miroir, ou à éviter les miroirs pour ne pas voir votre image.
- Vous avez l’impression que tout le monde remarque votre « défaut », même quand on vous dit le contraire.
- Vous avez déjà consulté plusieurs praticiens pour le même problème, ou tenté différentes interventions sans jamais être satisfait(e).
- Vous vous comparez sans cesse aux autres (notamment sur les réseaux sociaux).
- Vous ressentez une grande anxiété sociale ou vous évitez les interactions à cause de votre apparence.
- Vous avez des pensées noires, de la tristesse, voire des idées suicidaires.
Ces comportements ne sont pas anodins. Ils traduisent une réelle souffrance, qu’il ne faut ni minimiser, ni ignorer.
Une société qui entretient le mal-être
Nous vivons dans un monde où l’image est omniprésente. Les filtres Instagram, les retouches sur les photos, les influenceurs à l’apparence « parfaite »… tout cela crée des standards de beauté irréalistes. Et plus on s’y compare, plus on risque de se sentir « anormal ».
Certains parlent même aujourd’hui de « Snapchat dysmorphia » : des personnes qui demandent à leur médecin de les faire ressembler à leur propre image retouchée. Cela montre à quel point la frontière entre le réel et l’imaginaire peut se brouiller, au détriment de l’estime de soi. Les adolescents et jeunes adultes sont particulièrement vulnérables car leur identité est encore en construction et leur exposition aux réseaux sociaux est massive.
Ce que la médecine esthétique peut (et ne peut pas) faire
Il est important de comprendre que la médecine esthétique ne peut pas tout régler. Lorsqu’une personne souffre de dysmorphophobie, aucun acte – aussi bien réalisé soit-il – ne lui apportera la satisfaction recherchée. Pire encore : cela peut aggraver la souffrance, en entretenant l’illusion qu’un nouveau soin réglera le problème.
C’est pourquoi les praticiens sérieux peuvent refuser une intervention, quand ils sentent que la demande est inadaptée ou motivée par une souffrance psychologique profonde. Ce n’est pas un rejet : c’est un acte de responsabilité et d’humanité. Certains d’entre eux utilisent des questionnaires de dépistage standardisés, comme le Body Dysmorphic Disorder Questionnaire (BDDQ) pour identifier les patients à risque.
Comment sortir de ce cercle vicieux ?
La dysmorphophobie se soigne. La première étape est de reconnaître qu’il ne s’agit pas d’un problème physique mais d’un trouble de l’image de soi.
Les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) sont très efficaces pour aider à :
- Identifier les pensées négatives et exagérées.
- Travailler sur l’acceptation de soi.
- Reprendre confiance dans son corps et son apparence.
Dans certains cas, un traitement médicamenteux, prescrit par un psychiatre (généralement un antidépresseur spécifique), peut être utile en complément.
Le plus important est d’avoir un accompagnement bienveillant, qui ne juge pas mais qui aide à mieux comprendre ce qu’on vit. Le soutien des proches est également essentiel : écouter sans banaliser, encourager à consulter, et éviter les remarques sur l’apparence peuvent faire une réelle différence.
En conclusion
Le regard que l’on porte sur soi peut devenir une prison. La dysmorphophobie est un trouble encore trop souvent ignoré, alors qu’il est fréquent, surtout chez les personnes en quête de solutions esthétiques.
Si vous vous reconnaissez dans ces lignes, ou si vous connaissez quelqu’un dans ce cas : parlez-en à un professionnel de santé. Il existe des solutions, et surtout, il existe une voie pour sortir de cette souffrance.
La beauté commence toujours par une paix intérieure. Parfois, c’est en prenant soin de sa santé mentale que l’on commence à vraiment se réconcilier avec son image.




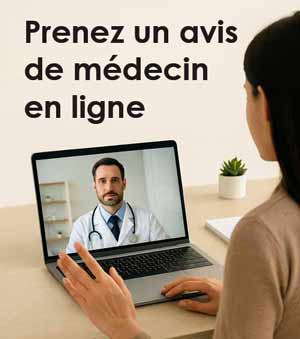





Un commentaire
j’en suis atteinte depuis les premières remarques sur mon physique avant le collège, a l’époque c’était totalement minimisé et invalidé (c’est la crise d’adolescence, il y a des problèmes plus graves, tu exagères etc) ça a eu des répercussions dramatiques sur toute ma scolarité puis études et vie professionnelle par la suite ce qui m’a coûté rien moins que la vie que je comptais vivre, j’ai développé de profonds troubles identitaires et des complexes dans pratiquement tous les domaines donc effectivement c’est à prendre au sérieux.
Aujourd’hui j’ arrive à faire avec mon apparence mais le seul moment où j’en ai été libérée c’était sous antidépresseurs. Je parviens aussi à faire la part des défauts auxquels je ne pourrai jamais m habituer et dont la correction me changerait la vie si j’avais les moyens d’y remédier (profiloplastie, génioplastie surtout) et de ceux dont j’ai conscience que l amélioration ne serait que temporaire. Dans tous les cas je m’en remettrai de toute façon à un avis professionnel sérieux, je suis le mieux placée pour savoir ce que je ressens mais pas pour déterminer objectivement ce qui devrait et pourrait être corrigé ou pas et envisage une TCC.
Merci pour cet article.